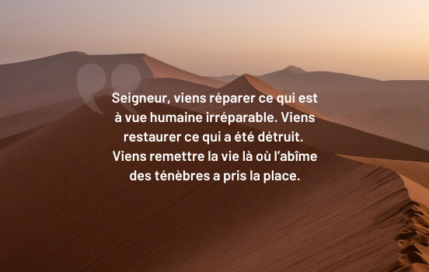Bienvenue sur le site de la paroisse de Mérignac
Accueil de la Paroisse de Mérignac
105 Avenue de l’Yser Mérignac
Tél : 05 56 34 41 49
Mail : contact@paroissemerignac.fr
Du lundi au samedi de 9h30 à 11h30
Vers une communauté de "Disciples missionnaires"
La communauté catholique de Mérignac est heureuse de vous proposer un guide 2024.
Que vous soyez un nouvel arrivant sur le DOYENNÉ de BORDEAUX OUEST Paroisse de Mérignac qui comprend Saint Vincent de Mérignac et Sainte Bernadette de Mérignac ou un habitué vous pourrez y trouver de nombreuses informations pratiques sur la vie de Saint-Vincent et de Sainte-Bernadette.
Répartie sur la grande commune de Mérignac la communauté chrétienne essaie de vivre à la suite du Christ dans la dynamique engendrée par le dernier synode diocésain.
L’objectif pastoral est de marcher ensemble « Vers une Communauté de Disciples Missionnaires ». – Vers : C’est une progression à laquelle chacun est invité personnellement et en Église. – Une communauté : La dimension fraternelle doit être un aspect central de notre foi. – De disciples : C’est-à-dire des croyants qui cherchent à ajuster toujours mieux le cœur à celui de Jésus en lui donnant une place centrale et en travaillant à mieux écouter sa Parole. – Missionnaires : Car la Foi grandit et se vivifie quand elle est annoncée et partagée. Prions pour que l’Esprit Saint nous aide à mettre nos talents au service du Seigneur afin que la communauté chrétienne de Mérignac devienne de plus en plus témoin de Celui qui est le Chemin, la Vérité et la Vie (Jean 14,6).

P. Bruno DELMAS
Curé de la paroisse de Mérignac
NOS PHOTOS